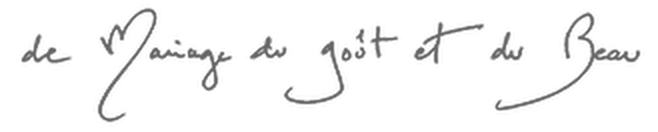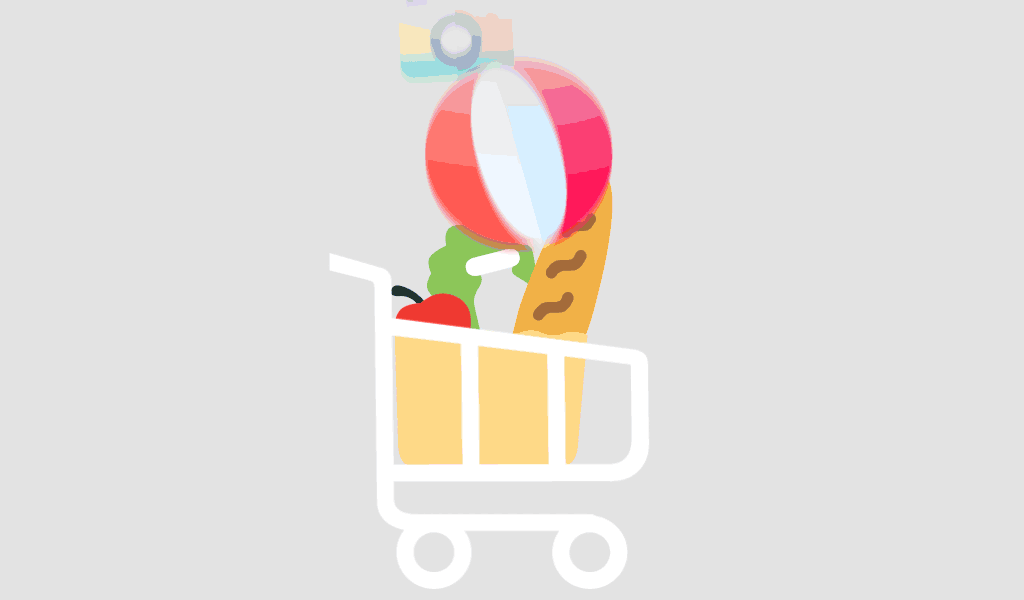Le vin naît bien avant la cave. Il naît dans la vigne, au fil d’un cycle végétatif régulier, mais jamais identique d’une année à l’autre. Débourrement, floraison, nouaison, véraison, maturation… Autant d’étapes qui transforment une simple plante en source d’émotion et de culture. Comprendre ces étapes, c’est poser un regard plus sensible sur ce que l’on déguste.

L’hiver (décembre à février) : le repos végétatif
Durant l’hiver, la vigne entre dans sa phase de repos végétatif, aussi appelée dormance hivernale. Cette période, bien que silencieuse en apparence, est cruciale pour le bon déroulement du cycle viticole. En l’absence de chaleur et de lumière suffisantes, la plante cesse toute activité visible.
Le feuillage est tombé, les grappes ont été vendangées, les sarments sont nus, et la sève est descendue dans les racines pour se mettre à l’abri du gel. Ce repos permet à la vigne de reconstituer ses réserves après l’effort intense de la fructification et de la maturation. Elle entre en léthargie pour se protéger des températures parfois extrêmes. Ce processus est comparable à l’hibernation chez certains animaux : tout est mis en pause pour mieux repartir au printemps.
Le froid est paradoxalement bénéfique. Il aide à limiter la prolifération des maladies et des insectes nuisibles en détruisant leurs œufs et spores. Un hiver rigoureux peut donc s’avérer sain pour la vigne.

Le printemps (mars à mai) : le Débourrement et la floraison
Avec le retour des beaux jours, la vigne sort de sa torpeur hivernale. Lorsque les températures dépassent régulièrement 10°C, un phénomène impressionnant annonce la reprise du cycle : les pleurs. À la fin de l’hiver, la sève, attirée par la chaleur, remonte depuis les racines jusqu’aux extrémités des sarments taillés. Ce liquide s’écoule par les coupes : la vigne semble pleurer. Ce phénomène naturel est le premier signe visible de la reprise d’activité.
Quelques jours après le pleurage, les bourgeons gonflent, puis s’ouvrent : c’est le débourrement. De jeunes pousses vert tendre, appelées feuilles étalées, apparaissent. Elles donneront naissance aux rameaux, aux feuilles matures et aux futures inflorescences.
Le débourrement est l’un des moments les plus critiques de l’année. Les jeunes pousses sont extrêmement sensibles aux gelées printanières, qui peuvent anéantir toute une récolte en quelques heures.

La floraison (fin mai à début juin)
Si le climat reste favorable, la vigne continue sa croissance et entre dans la phase de floraison. De minuscules fleurs blanches et discrètes se forment à l’extrémité des jeunes rameaux. Ce sont elles qui donneront naissance aux baies (futures grappes de raisin) si elles sont bien fécondées.
La floraison dépend beaucoup des conditions météorologiques :
- 🌞 Un temps sec, chaud et peu venteux est idéal.
- 🌧️ Un épisode de pluie ou de froid peut provoquer la coulure : les fleurs avortent, et ne se transforment pas en fruits.
- 🌪️ Le vent peut gêner la pollinisation, qui, rappelons-le, est autogame chez la vigne (la fleur se féconde elle-même).
Le printemps est la saison de la relance végétative. Tout se joue à ce moment : un débourrement harmonieux et une floraison réussie conditionnent la quantité et la qualité des futures grappes.


L’été (juin à août) : la Croissance et concentration
L’été est une période de pleine activité physiologique pour la vigne. Après la floraison, si la fécondation a été réussie, les fleurs donnent naissance à de petites baies vertes : c’est le début d’une transformation lente et spectaculaire.
La nouaison (fin juin / début juillet)
La nouaison désigne la transformation des fleurs fécondées en jeunes fruits. Les grains de raisin se forment à la place des fleurs et commencent leur croissance. À ce stade, les baies sont encore petites, vertes et dures, riches en acides et sans sucres. Cette phase est capitale : elle détermine le nombre et le volume des futurs raisins. Tout stress (climatique, sanitaire ou hydrique) peut perturber la nouaison et entraîner la coulure ou le millerandage (grains petits et sans pépins).
La véraison (mi-juillet à août)
Vers la mi-été, les raisins entament un changement de couleur progressif :
- Les cépages rouges passent du vert au rose, puis au violet foncé.
- Les cépages blancs virent du vert au jaune doré.
Ce phénomène s’appelle la véraison. C’est aussi le début de la maturation :
- La teneur en sucres augmente,
- Les acides diminuent,
- Les arômes spécifiques au cépage se développent,
- Les composés phénoliques (tanins, anthocyanes) s’accumulent dans la pellicule.
La véraison ne se produit pas uniformément : elle peut s’étaler sur plusieurs jours ou semaines selon les cépages, les expositions et les conditions climatiques.
L’automne (septembre à novembre) : la Maturité et les vendanges
Durant cette période, les vignerons surveillent de très près l’évolution des baies, car le moment de la récolte conditionne directement le style et la qualité du vin final. Il ne s’agit pas seulement de ramasser les raisins mûrs, mais de choisir le moment optimal pour atteindre le profil recherché — qu’il s’agisse d’un vin sec, d’un moelleux, d’un effervescent ou d’un vin de garde.
Pour cela, plusieurs critères analytiques et sensoriels sont évalués :
- Les arômes variétaux : leur expression donne des indices sur la typicité du cépage et la complexité du futur vin. Les baies sont régulièrement goûtées pour évaluer la finesse et la richesse aromatique.
- La teneur en sucre : mesurée en grammes par litre, elle permet d’estimer le degré alcoolique potentiel du vin.
- L’acidité totale et le pH : une acidité trop basse donne un vin plat, une acidité trop élevée un vin dur ; l’équilibre est donc essentiel.
- La maturité phénolique : elle concerne les tanins (présents dans les pépins, la peau et les rafles) et les anthocyanes (responsables de la couleur dans les rouges). Ils doivent être mûrs, souples, non astringents.

Après les vendanges, la vigne entre en pré-dormance. Les feuilles tombent, la sève redescend, et le cycle recommence.